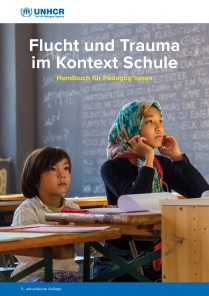La guerre et l’exil sont lourdes de conséquences pour les personnes qui en ont fait l’expérience. Environ la moitié des adultes réfugiés dans les pays occidentaux souffrent de troubles post-traumatiques. Les enfants et les adolescents ne sont pas épargnés.
Les symptômes peuvent aussi se manifester de façon différée: par exemple lorsque des conditions d’hébergement et de prise en charge stables sont assurées.
Toutes les personnes en contact avec les réfugiés peuvent contribuer à transmettre un sentiment de sécurité et de stabilité. S’ancrer dans le présent peut aider les personnes concernées à se sentir plus en sécurité.